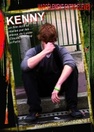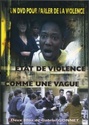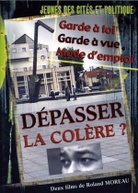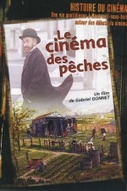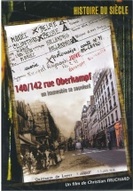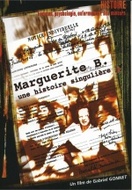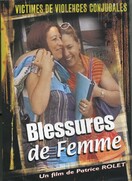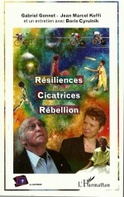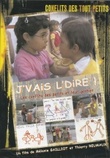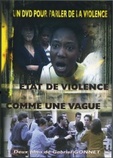-
Par La CATHODE le 8 Février 2016 à 12:10
LES DVD POUR EN PARLER : SANTÉ - PRÉVENTION - FORMATION ALCOOL - DROGUE - TENTATIVE DE SUICIDE - RÉSILIENCE
Cliquez sur les couvertures DVD pour accéder aux fiches des films
DOSSIERS D'ACCOMPAGNEMENT et RESSOURCES
Kenny : un DVD pour parler du harcèlement entre élèves de Gabriel GONNET - PDF Voir le making of Voir l'extrait
Le Journal d'Elise : un DVD pour parler des relations amoureuses d'Arlette GIRARDOT - PDF Voir l'extrait
Un DVD pour parler de la Solitude - PDF
Un DVD pour parler d'immigration : le vote des étrangers et Mon père, ma mère ces étrangers
Cicatrices : Un DVD pour parler de la résilience de Gabriel GONNET - PDF Voir la bande annonce
DVD + Livre : Résiliences cicatrices Rébellion NOUVEAU - PDF Dossier d'accompagnement - PDF
Un DVD pour parler d'Alcool et de Politoxicomanie de Roland MOREAU - PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Un DVD pour parler de la violence de Gabriel GONNET - PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Un DVD pour parler de la Tentative de Suicide de Gabriel GONNET - PDF Voir l'extrait
Un DVD pour parler de la relation Parents -Ados - PDF Voir l'extrait
Interventions des réalisateurs autour des films : harcèlement scolaire, non violence à l'école, conseil d'enfants, vivre ensemble, climat scolaire citoyenneté scolaire, parentalité, rapport Parents/école, coéducation, éducation partagèe, résilence, résilience collective, histoire ...Contact : 06 07 96 04 53 contact@lacathode.org
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La CATHODE le 8 Février 2016 à 11:48
CITOYENNETÉ - INSERTION
Cliquez sur les couvertures DVD pour accéder aux fiches des films
DOSSIERS D'ACCOMPAGNEMENT et RESSOURCES
Dépasser la colère de Roland MOREAU - Implication citoyenne des jeunes - PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Un DVD pour parler d'immigration : le vote des étrangers et Mon père, ma mère ces étrangers
Comment je m'en sors? Dossier de presse Extrait du film : comment je m'en sors? de Roland MOREAU - Insertion sociale et professionnlelle
Le film Raconte Moi Icare sur la mobilisation par la Culture des personnes au RMI Sujet du Conseil Général du Val de Marne sur Raconte Moi Icare
Articles
La Dynamique des personnes par Gabriel GONNET
La question d'une résilience collective par Jean Marcel KOFFI et Gabriel GONNET
Interventions des réalisateurs autour des films : harcèlement scolaire, non violence à l'école, conseil d'enfants, vivre ensemble, climat scolaire citoyenneté scolaire, parentalité, rapport Parents/école, coéducation, éducation partagèe, résilence, résilience collective, histoire ...Contact : 06 07 96 04 53 contact@lacathode.org
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La CATHODE le 8 Février 2016 à 11:39
HISTOIRE
Cliquez sur les couvertures DVD pour accéder aux fiches des films
DOSSIERS D'ACCOMPAGNEMENT et RESSOURCES
Le cinéma des pêches de Gabriel GONNET - Histoire du Cinéma - PDF
Mémoires de vie : mémoire de la Shoah de Bouralfa DJOUANI - PDF Voir l'extrait
140-142 Rue Oberkamf : un immeuble se souvient de Christian FRUCHARD - Histoire d'un siècle - PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Paula et Paulette ma mère de Claude WEISZ - Parcours de vie - PDF
Marguerite B.: une histoire singulière de Gabriel GONNET- Histoire de l'enfermement des mineur - PDF Voir l'extrait ( Uilisation personnelle uniquement)
Interventions des réalisateurs autour des films : harcèlement scolaire, non violence à l'école, conseil d'enfants, vivre ensemble, climat scolaire citoyenneté scolaire, parentalité, rapport Parents/école, coéducation, éducation partagèe, résilence, résilience collective, histoire ...Contact : 06 07 96 04 53 contact@lacathode.org
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La CATHODE le 8 Février 2016 à 11:29
FEMMES - RELATION GARÇONS FILLES - RELATIONS AMOUREUSES
Cliquez sur les couvertures DVD pour accéder aux fiches des films
DOSSIERS D'ACCOMPAGNEMENT et RESSOURCES
Le Journal d'Elise : un DVD pour parler des relations amoureuses d'Arlette GIRARDOT - PDF Voir l'extrait
Blessures de femmes : violences conjugales de Patrice ROLET - PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Un enfant tout de suite de Chantal BRIET - Grossesses adolescentes -PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Extrait du film Fait maison de Marinca VILLANOVA - Femmes de l'immigration
Marguerite B.: une histoire singulière de Gabriel GONNET - Histoire de l'enfermement des mineur - PDF Voir l'extrait ( Uilisation personnelle uniquement)
Interventions des réalisateurs autour des films : harcèlement scolaire, non violence à l'école, conseil d'enfants, vivre ensemble, climat scolaire citoyenneté scolaire, parentalité, rapport Parents/école, coéducation, éducation partagèe, résilience, résilience collective, histoire ...Contact : 06 07 96 04 53 contact@lacathode.org
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La CATHODE le 8 Février 2016 à 10:57
RÉSILIENCES
Cliquez sur les couvertures DVD pour accéder aux fiches des films
DOSSIERS D'ACCOMPAGNEMENT et RESSOURCES
Cicatrices : Un DVD pour parler de la résilience de Gabriel GONNET - PDF Voir la bande annonce
DVD + Livre : Résiliences cicatrices Rébellion NOUVEAU - PDF Dossier d'accompagnement - PDF
Mémoires de vie : mémoire de la Shoah de Bouralfa DJOUANI - PDF Voir l'extrait
Blessures de femmes : violences conjugales de Patrice ROLET - PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Comment je m'en sors? Dossier de presse Extrait du film : comment je m'en sors? de Roland MOREAU - Insertion sociale et professionnlelle
Comme une vague : un DVD pour parler de la violence de Gabriel GONNET - PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Articles :
La Dynamique des personnes par Gabriel GONNET
La question d'une résilience collective par Jean Marcel KOFFI et Gabriel GONNET
Interventions des réalisateurs autour des films : harcèlement scolaire, non violence à l'école, conseil d'enfants, vivre ensemble, climat scolaire citoyenneté scolaire, parentalité, rapport Parents/école, coéducation, éducation partagèe, résilence, résilience collective, histoire ...Contact : 06 07 96 04 53 contact@lacathode.org
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La CATHODE le 8 Février 2016 à 10:25
PARENTALITÉS
Cliquez sur les couvertures DVD pour accéder aux fiches des films
DOSSIERS D'ACCOMPAGNEMENT et RESSOURCES
Un enfant tout de suite - Grossesses adolescentes
Parents malgré tout - parentalité et handicap
Demain sera plus beau ... Familles de sans papiers
Après la mine : pouvoir d'agir des parents, universités populaires de parents - PDF Bande Annonce
Faut il apprendre à être parents? de Dominique DELATTRE - PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Le grand malentendu : le rapport Parents/École de Dominique DELATTRE - PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Être père aujourd'hui - PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Extrait du film Fait maison de Marinca VILLANOVA - Femmes de l'immigration
Mon père, ma mère ces étrangers
Un DVD pour parler de la relation Parents -Ados - PDF Voir l'extrait
Articles :
Le Samedi Matin au Collège : coéducation, éducation partagée Un samedi matin à l'université
Le Samedi Matin au Collège : une expérience d’éducation partagée au Collège Jean Jaurès de Pantin
Interventions des réalisateurs autour des films : harcèlement scolaire, non violence à l'école, conseil d'enfants, vivre ensemble, climat scolaire citoyenneté scolaire, parentalité, rapport Parents/école, coéducation, éducation partagèe, résilence, résilience collective, histoire ... Contact : 06 07 96 04 53 contact@lacathode.org
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La CATHODE le 8 Février 2016 à 09:51
VIOLENCE - NON VIOLENCE - HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Cliquez sur les couvertures DVD pour accéder aux fiches des films
LES DOSSIERS D'ACCOMPAGNEMENT ET LES RESSOURCES
KENNY Un DVD pour parler du harcèlement entre élèves de Gabriel GONNET- PDF Voir le making of Un extrait BA : un Après-midi au Collège : devenir médiateur La CATHODE soutient la Campagne contre le harcèlement scolaire avec 7 DVD
Sur le chemin de l'école de la non violence - Dossier d'accompagnement du film - PDF Voir l'extrait
J'vais le dire : les confilts des petits à la maternelle de M. GAILLOT et T. REUMAUX - PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Un DVD pour parler de la violence de Gabriel GONNET - PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Esquive de Patrice ROLET- Boxe éducative - PDF Voir l'extrait
Blessures de femmes : violences conjugales de Patrice ROLET - PDF Voir l'extrait (Uilisation personnelle uniquement)
Marguerite B.: une histoire singulière de Gabriel GONNET - Histoire de l'enfermement des mineur - PDF Voir l'extrait ( Uilisation personnelle uniquement)
Article :
Des groupes positifs, créatifs et solidaires : pour un autre fonctionnement des groupes
Interventions des réalisateurs autour des films : harcèlement scolaire, non violence à l'école, conseil d'enfants, vivre ensemble, climat scolaire citoyenneté scolaire, parentalité, rapport Parents/école, coéducation, éducation partagèe, résilence, résilience collective, histoire ... Contact : 06 07 96 04 53 contact@lacathode.org
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La CATHODE le 8 Mars 2015 à 21:24
Un DVD pour Aller vers les SDF - Psychologie
Les passeurs de soins
Documentaire de 52’, écrit et réalisé par Philippe Masse (2014) Production : Mil Sabords / France 3 Nord-Ouest et France Télévisions. Images : Marc Toulin ; Son : Michel Lesaffre ; Montage : Laurent Pannier. Avec la participation de la Région Haute-Normandie, du CNC, de la Procirep et du RRRAP.
Dans l’agglomération rouennaise, une équipe psychiatrique, la première de France, part quotidiennement à la rencontre de ceux qui ne se soignent jamais, et qui vivent dans la rue, les grands précaires, clochards, migrants, jeunes en errance, femmes. Des psys et des infirmiers tentent de restaurer la dimension psychique et historique de ces personnes. Ils les rencontrent dans les centres d’hébergement et les amènent, peu à peu, en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux, à accepter de se prendre en charge sur le plan physique et psychologique. Le documentaire raconte le quotidien de cette équipe, et montre notre société coincée entre le rejet et la compassion, bien embarrassée face à la question de ses marginaux, anti-modèles au pays de l’excellence et de la performance.
Diffusions : France 3 Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Centre, Ile de France. En salle dans deux cinémas de Rouen (Ariel et Melville). Conseil général de l’Eure. Soirées débat en institution et école du travail social. Clé d’argent au festival Vidéo Psy de Lorquin 2014. Sélection au FIGRA 2015, compétition internationale + de 40’ et prix de la 1è œuvre.
PRESSE :
Paris Normandie du 16/12/2013 : Un documentaire sur les « psys de la rue » à Rouen
«C'est un monde de paradoxes, parfois absurde », glisse le réalisateur Philippe Masse, qui fut aussi psychologue pendant quinze ans avant de se pencher sur l'insertion. Il vient d'achever un documentaire de 52 minutes, « Les passeurs de soins », qui a suivi le quotidien de l'Unité Mobile d'Action Psy Précarité (UMAPP), un groupe de quinze soignants (psychologues, psychiatre, infirmiers psychiatriques) qui va à la rencontre des personnes en grande précarité.
« L'UMAPP, c'est une équipe d'urgence qui ne travaille pas dans l'urgence, qui rencontre des personnes qui ne veulent pas toujours se soigner et qui œuvre en partenariat avec les travailleurs sociaux » (…)Lien social du 4 au 17 septembre 2014 : Les passeurs de soins
Cette unité se veut l’alliance du médical, du psychiatrique et du social qui, selon Philippe Masse, « n’est pas naturelle ». Une mission en effet complexe dans un contexte extrêmement difficile. Par petites touches, le documentaire révèle un dispositif d’urgence sociale qui aide et violente à la fois. « On ne peut même pas les faire tourner un jour sur deux » lâche le coordinateur du 115. Il vient d’expliquer au téléphone à un appelant qu’il n’y a pas de place pour lui ce soir vu qu’il a déjà obtenu une place la nuit précédente. Dans ce milieu, l’équipe de l’UMAPP tente de garder le lien. « Ils travaillent avec l’urgence mais sans urgence », analyse Philippe Masse (…)
LE RÉALISATEUR : Philippe MASSE
Psychologue clinicien et pathologiste de formation (Université de Paris V), il écrit son 1er film en 1992, un polar pédagogique sur les modes de communication interpersonnelles, produit et tourné par l’AFPA. Journaliste en 1999, après deux ans de formation au CFPJ Paris, il devient producteur (formation à l’INA), scénariste, présentateur de séries télévisées institutionnelles dédiées à la formation professionnelle. Après une quarantaine de séries, et 3 récompenses en festival : prix du meilleur clip métier à Pézenas, prix des 10 meilleurs films aux entretiens de Bichat pour une docu-fiction, et laurier de bronze au festival du Creusot (prix du meilleur film de formation), il choisit de voler de ses propres ailes et de s’attaquer au documentaire. « Les passeurs de soins » est son premier travail sur ce nouveau champ.
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par La CATHODE le 27 Février 2015 à 10:53
VIE DE BÉBÉ
PREMIERS MOIS
DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT DU FILM
Un film de Catherine Guéneau et Gérard Leblanc
Documentaire : 75mn.- 2005
Autoproduction - Distribution DVD : La CATHODE
PREMIERS MOIS DE LA VIE DU BÉBÉ
Comment se développent et s’organisent les interactions entre un bébé et son environnement d’abord parental au cours des premiers mois de sa vie. Le film établit sa progression narrative sur les relations toujours plus riches et complexes qui se construisent entre le bébé et ses parents, chacun cherchant à comprendre les besoins et les désirs de l’autre et à les satisfaire.
Catherine Guéneau et Gérard Leblanc ont filmé leur bébé Lucas durant la première année de sa vie.
Bonus : commentaire sur les images du film par Claude BAILBLÉ, Maître de Conférence à l’université Paris VIII, Professeur à la FEMIS. - 21mn.
Commentaire
“ Le film pose continuellement cet aller-retour entre une observation qui peut paraître très descriptive alors qu’elle ne l’est pas et des réflexions qui peuvent paraître très abstraites alors qu’elles ne le sont pas. C’est là où le spectateur est appelé à reconsidérer ses habitudes de vision et à relier autrement des choses qui sont habituellement non filmées. (…) Quelque chose d’assez indéfinissable, mais qui mobilise chez le spectateur un questionnement neuf et qui l’oblige à se poser des questions y compris sur ses habitudes de cinéma. ”
Claude BAIBLÈ- extrait du bonus DVD
LES RÉALISATEURS
Catherine Guéneau a étudié la scénarisation cinématographique et les sciences sociales à l’Université du Québec à Montréal. Elle a exercé des activités d’enseignement en France et à l’étranger pendant plusieurs années. Actuellement, elle est réalisatrice et prépare une thèse sur la question des dispositifs numériques au cinéma.
Gérard Leblanc est critique de cinéma et Professeur des universités à l’École Nationale Louis Lumière. Par ailleurs, il a également dirigé les revues Médecine-Cinéma et Cinéthique, et a écrit de nombreux ouvrages. Ses réflexions se construisent et se reconstruisent sans cesse à partir d’un questionnement toujours recommencé sur les relations entre le cinéma et la vie.
Filmographie
“ Analyse par l’image de The birth of a nation ”, D.W Griffith, 36 mn (co-auteur Nicolas STERN), Quintet Film, Paris, 1987, diffusion Images de la Culture, Centre National du Cinéma ; “ En amour ” (co-réalisation Catherine GUÉNEAU), 30mn, Groupe de Recherches et d’Etudes Cinématographiques, 2001 ; “ Quand on aime la vie, on va au cinéma ”, 16 mm, 90mn, 1975, Film sélectionné au Festival de Cannes dans la section “ Perspectives du cinéma français ”. Bon pied bon œil et toute sa tête, 16 mm, 87 mn, 1979.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La CATHODE le 15 Octobre 2014 à 14:45
Un DVD pour parler d'INSERTION
COMMENT JE M'EN SORS ?
Un film de Roland MOREAU
Dossier d'accompagnement du film en PDF
Comment je m'en sors?
Documentaire de 55 mn. -1999
Un film de Roland MOREAU - Prix des 10 meilleurs films au festival médical des entretiens de BIchat 1999
La CATHODE, Téléssonne avec le soutien de Conseil Général du Val de Marne, du Ministère des Affaires sociales, de la PROCIREP, de la DIV et de Périphérie
C'est la question obsédante pour toutes les personnes en quête d'insertion. Jeune chômeur, toxicomane, ex détenu, chacun fait son chemin. Mais, est ce encore possible dans une société où tout le monde doit gagner? Comment devient t'on sujet de son histoire? Derrière les témoignages, il y a la souffrance que l'on cache. Ce documentaire est une galerie de portraits de personnes en quête d'un travail, d'une formation, mais surtout d'une place dans la société.
Avec Zoïr, Laetitia, Thierry, Philippe, Christophe, Christelle, Rabah, Kamel.
LE RÉALISATEUR
Roland MOREAU commence par réaliser des films Super 8 et à jouer au théâtre comme comédien amateur puis professionnel. Après une licence d'histoire, Il réalise deux courts-métrages en 35 mm "Vue sur la mer" et "La croisée des chemins", ainsi qu'une série de programmes courts "Une Images pour les Droits de l'Homme" diffusée sur France 3. En 1993, il entreprend son premier long-métrage " L'homme qui marche ", histoire d'un personnage qui part à la recherche de lui-même à travers la marche à pied. Il réalise plusieurs films documentaires sur des sujets de société avec La Cathode. Ce cheminement l'a conduit à une posture de réalisateur engagé et de producteur indépendant impliqué dans le monde associatif.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Des cinéastes au cœur du social et de la Seine-Saint-Denis